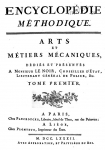 Les Lumières évoquent un idéal qui s’est construit au fil du temps, s’appuyant pour partie sur ce que les générations successives projetaient sur ce mouvement à dimension européenne. La force et l’importance en termes de valeurs de cet héritage sont telles que Philippe Sollers, dans un article écrit pour Le Nouvel Observateur en 2006 réclame : « Rallumez les Lumières » ; que la chaîne Arte propose une série de documentaires intitulée : « Les Lumières au XXIème siècle », moment où semblent menacés progrès, prééminence de la raison, et droits de l’homme. Le projet encyclopédique de Diderot et d’Alembert semble représentatif de l’esprit des Lumières. Il s’inscrit dans l’effervescence du siècle, dans l’héritage humaniste à vouloir mettre l’homme à nouveau au cœur de la réflexion(1), qui doit rechercher le bonheur sur terre, et non dans un hypothétique salut.
Les Lumières évoquent un idéal qui s’est construit au fil du temps, s’appuyant pour partie sur ce que les générations successives projetaient sur ce mouvement à dimension européenne. La force et l’importance en termes de valeurs de cet héritage sont telles que Philippe Sollers, dans un article écrit pour Le Nouvel Observateur en 2006 réclame : « Rallumez les Lumières » ; que la chaîne Arte propose une série de documentaires intitulée : « Les Lumières au XXIème siècle », moment où semblent menacés progrès, prééminence de la raison, et droits de l’homme. Le projet encyclopédique de Diderot et d’Alembert semble représentatif de l’esprit des Lumières. Il s’inscrit dans l’effervescence du siècle, dans l’héritage humaniste à vouloir mettre l’homme à nouveau au cœur de la réflexion(1), qui doit rechercher le bonheur sur terre, et non dans un hypothétique salut.
Humanisme et Lumières
-
L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert : « rassembler ce qui est épars »
-
Pour un nouveau Contrat social
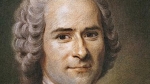
Ce texte n’est pas un projet de Contrat Social. Ce n’est qu’une réflexion sur ce sujet qui mériterait d’ailleurs plusieurs approches différentes. Je présente ici la mienne. Elle part du rappel de l’idée de contrat social, exprimée par J.-J. Rousseau dont j’examine la difficile application de certains principes.
Je développe ensuite les difficultés, de la réalisation du contrat pour l’édification d’une République sociale, en m’appuyant sur l’ouvrage de Danièle Sallenave, « La splendide promesse ».
Et je termine par une conclusion personnelle, un peu pessimiste.
-
Agir ensemble
 Concurrence ou mise en commun : quels choix entre guerre et fraternité pour la construction d'un monde meilleur ?
Concurrence ou mise en commun : quels choix entre guerre et fraternité pour la construction d'un monde meilleur ?Contribution à la recherche de nouvelles constructions sociales
-
Sommes-nous des Êtres responsables ?
 Pour répondre à cette question il est nécessaire de définir cette notion de « Êtres responsables ». Par nos actes, nos écrits, nos positions, etc., c’est notre responsabilité qui se trouve engagée, et elle est souvent considérée – un peu rapidement – comme seulement individuelle, alors qu’elle s’inscrit toujours et inévitablement en écho dans une responsabilité collective qui nous incombe, alors oui, par nécessité, devoir et fraternité nous nous devons d’êtres des Êtres responsables.
Pour répondre à cette question il est nécessaire de définir cette notion de « Êtres responsables ». Par nos actes, nos écrits, nos positions, etc., c’est notre responsabilité qui se trouve engagée, et elle est souvent considérée – un peu rapidement – comme seulement individuelle, alors qu’elle s’inscrit toujours et inévitablement en écho dans une responsabilité collective qui nous incombe, alors oui, par nécessité, devoir et fraternité nous nous devons d’êtres des Êtres responsables. -
La laïcité comme garantie de l'espace public
 Depuis 1905, les choses ont bien changé : la répartition du panorama des religions et la manière dont celles-ci s'immiscent dans la vie des sociétés ont évolué. D'autre part, la mondialisation et les structures supranationales, dont l'impact juridique bat en brèche l’État-nation, modifient non seulement les frontières de l'espace public mais encore sa consistance même.
Depuis 1905, les choses ont bien changé : la répartition du panorama des religions et la manière dont celles-ci s'immiscent dans la vie des sociétés ont évolué. D'autre part, la mondialisation et les structures supranationales, dont l'impact juridique bat en brèche l’État-nation, modifient non seulement les frontières de l'espace public mais encore sa consistance même.Or l'espace public est le lieu du débat, lieu dans lequel le citoyen participe à l'élaboration des règles de la société.