 L’humanisme s’oppose au relativisme parce que c’est un universalisme, et un universalisme éthique. Chez Jaurès, l’éthique [1] et l’ontologique sont en surimpression. Emmanuel Lévinas a pu dire [2] à propos de la philosophie d’Ernst Bloch, marxiste non orthodoxe que « l’accomplissement de l’homme (était pour lui) l’accomplissement de l’être en vérité ». Cet accomplissement caractérise aussi l’éthique jaurésienne et c’est ce que je voudrais vous montrer. Chez Jaurès en effet l’éthique puise sa source dans ce qu’il appelle l’infini (Dieu), mais en même temps Jaurès affirme que l’humanité forge ses valeurs en elle-même. L’éthique, comme on va le voir, s’origine dans une métaphysique de l’être mais s’autonomise et se réalise dans la volonté d’agir selon la justice pour construire l’humanité, encore constituée de « fragments ». La conception de l’unité de l’être[3] que traduira l’idée de solidarité universelle donne un fondement à la fraternité humaine. Être en fraternité, c’est faire humanité avec toute être humain. Il y a chez Jaurès comme une humilité du savoir. Ceux-ci sont encore trop partiels pour appréhender la complexité du réel, et nos valeurs sont encore trop tributaires des circonstances et du milieu historique, même si elles captent une part de l’idéal dont nous verrons qu’il est aussi le réel. L’éthique jaurésienne va de pair avec une raison rectificatrice qui pointe l’idéal dans l’universel, lequel contient plus que le savoir et les valeurs du moment. J’ai avancé l’idée d’une cosmopolitique pour caractériser la vision cosmique et éthique de Jaurès[4]. Dans une conférence récente à Toulouse sur Jean Jaurès, un humanisme pour le XXIème siècle, j’établissais un lien fort entre l’humanisme en acte et l’entreprise cosmopolitique pour l’humanité. Pour le comprendre, il faut s’intéresser à la philosophie de Jaurès.
L’humanisme s’oppose au relativisme parce que c’est un universalisme, et un universalisme éthique. Chez Jaurès, l’éthique [1] et l’ontologique sont en surimpression. Emmanuel Lévinas a pu dire [2] à propos de la philosophie d’Ernst Bloch, marxiste non orthodoxe que « l’accomplissement de l’homme (était pour lui) l’accomplissement de l’être en vérité ». Cet accomplissement caractérise aussi l’éthique jaurésienne et c’est ce que je voudrais vous montrer. Chez Jaurès en effet l’éthique puise sa source dans ce qu’il appelle l’infini (Dieu), mais en même temps Jaurès affirme que l’humanité forge ses valeurs en elle-même. L’éthique, comme on va le voir, s’origine dans une métaphysique de l’être mais s’autonomise et se réalise dans la volonté d’agir selon la justice pour construire l’humanité, encore constituée de « fragments ». La conception de l’unité de l’être[3] que traduira l’idée de solidarité universelle donne un fondement à la fraternité humaine. Être en fraternité, c’est faire humanité avec toute être humain. Il y a chez Jaurès comme une humilité du savoir. Ceux-ci sont encore trop partiels pour appréhender la complexité du réel, et nos valeurs sont encore trop tributaires des circonstances et du milieu historique, même si elles captent une part de l’idéal dont nous verrons qu’il est aussi le réel. L’éthique jaurésienne va de pair avec une raison rectificatrice qui pointe l’idéal dans l’universel, lequel contient plus que le savoir et les valeurs du moment. J’ai avancé l’idée d’une cosmopolitique pour caractériser la vision cosmique et éthique de Jaurès[4]. Dans une conférence récente à Toulouse sur Jean Jaurès, un humanisme pour le XXIème siècle, j’établissais un lien fort entre l’humanisme en acte et l’entreprise cosmopolitique pour l’humanité. Pour le comprendre, il faut s’intéresser à la philosophie de Jaurès.
Par Camille GROUSSELAS
Lire la suite
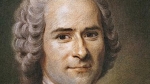
 L’humanisme s’oppose au relativisme parce que c’est un universalisme, et un universalisme éthique. Chez Jaurès, l’éthique
L’humanisme s’oppose au relativisme parce que c’est un universalisme, et un universalisme éthique. Chez Jaurès, l’éthique  Un récent voyage en Espagne m’a mené en Andalousie, de Murcie à Séville, en passant par Cordoue sur les traces d’Alphonse X le sage (Tolède 1221- Séville 1284).
Un récent voyage en Espagne m’a mené en Andalousie, de Murcie à Séville, en passant par Cordoue sur les traces d’Alphonse X le sage (Tolède 1221- Séville 1284).