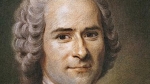
Ce texte n’est pas un projet de Contrat Social. Ce n’est qu’une réflexion sur ce sujet qui mériterait d’ailleurs plusieurs approches différentes. Je présente ici la mienne. Elle part du rappel de l’idée de contrat social, exprimée par J.-J. Rousseau dont j’examine la difficile application de certains principes.
Je développe ensuite les difficultés, de la réalisation du contrat pour l’édification d’une République sociale, en m’appuyant sur l’ouvrage de Danièle Sallenave, « La splendide promesse ».
Et je termine par une conclusion personnelle, un peu pessimiste.
S’agissant d’une réflexion sur un nouveau contrat social, on ne peut s’empêcher de faire référence à J.J. Rousseau, qui en 1762 publiait « Du Contrat Social[1] ». Nous résumerons ici en bref, et quoique très imparfaitement, ce que nous retenons de lui.
Dans l’article « Économie politique » de l’encyclopédie, Rousseau énonçait cette idée : « Il est certain que les peuples sont à la longue ce que le gouvernement les fait être. » D’où l’importance de la nature du gouvernement.
Dans « Du Contrat Social » il affirme le principe de la souveraineté du peuple, appuyée sur les notions de liberté, d’égalité et de volonté générale. La souveraineté populaire est seule légitime, il ne doit pas y avoir de souveraineté partagée. L’individu doit aliéner une part de sa liberté, au profit d’une communauté fondée sur la raison, la solidarité et le calcul.
Comment imposer une autorité légitime ? Par un contrat, qui stipule que c’est l’autorité de la société qui garantit la liberté civique, et par lequel chacun se fond dans la société, pour s’en remettre à la volonté générale.
Avec la pratique de l’agriculture s’est installé le droit de propriété. La liberté et l’égalité qui régnaient à l’état de nature se sont perdues avec la création de la propriété. Il faut donc repenser la société pour qu’elle soit juste. Rousseau a contesté les droits naturels selon Diderot ; pour lui il faut renoncer aux droits particuliers. L’intérêt particulier est contraire à la recherche de l’intérêt commun. Le droit du plus fort est incompatible avec l’intérêt commun, et donc avec le contrat social.
Le pacte social que propose Rousseau établit que le gouvernement émane du souverain qu’est le peuple. Chacun doit alors renoncer à tous ses droits particuliers, ou au droit du plus fort, pour obtenir l’égalité des droits que procure la société. Toutefois, l’homme n’aliène pas son droit naturel. Il comprend que le pacte social est, au contraire, la condition d’existence de ses droits naturels.
Par le contrat social, chacun renonce à sa liberté naturelle, pour gagner une liberté citoyenne. La souveraineté populaire est le principe fondamental du contrat. L’être humain aspire à la liberté. Mais la liberté n’est pas d’ordre naturel. Elle émane de conventions humaines et c’est le projet du contrat social. Le plus fort, pour pérenniser sa domination, veut toujours transformer sa force en droit, et l’obéissance en devoir. L’individu peut aliéner sa liberté et se soumettre ; il se vend alors pour sa subsistance. Mais le peuple qui se soumet au roi, n’a rien à en recevoir, c’est lui qui fournit au roi sa subsistance et sa force. Ainsi, la soumission au roi est-elle légitime ? « Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme. »
Le contrat entre le gouvernement et les gouvernés, suppose un échange équitable. Dans une société, il y a un peuple et son chef. La société est une association qui, de sa force commune, défend et protège la personne et les biens de chaque associé. Chacun s’associant à tous, n’obéit pourtant qu’à lui-même et reste libre. C’est le contrat social qui donne la solution à ce problème. Le contrat social constitue le pouvoir et légitime l’existence du peuple. Cet acte d’association, produit un corps moral collectif, d’autant de membres que l’assemblée a de voix. Par le contrat social, chacun se met sous la direction de la volonté générale. Se donnant à tous, il ne se donne à personne. Ce corps moral collectif constitue une République. Le peuple est constitué de citoyens participant à l’autorité souveraine, et en même temps sujets, soumis aux lois d’un État légitime, en vertu d’un contrat qui protège les individus contre l’oppression.
Le souverain est un collectif. Il est le peuple. Sa souveraineté est inaliénable. La volonté générale, guide l’action de l’État dans le sens du bien commun. L’exécutif est subordonné à la loi, édictée par le souverain qu’est le peuple. La volonté générale, peut néanmoins se dissoudre dans des associations partielles, dont la somme n’aboutit pas au bien commun. Toutefois la loi, fruit de la volonté générale, ne traite que du commun, pas du particulier. Faite par tout le peuple, elle s’exerce sur tout le peuple. Mais la loi est rédigée par un législateur. Elle doit néanmoins être en conformité avec la volonté générale. Le législateur écrit les lois, mais n’exerce aucun pouvoir. Les lois qu’il rédige, doivent exprimer la volonté du souverain, et avoir pour fin la liberté et l’égalité des membres.
L’égalité ne signifie pas que les degrés de puissance et de richesse soient les mêmes, « mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessous de toute violence et ne s’exerce jamais qu’en vertu du rang et des lois ; et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent, pour pouvoir en acheter un autre, et nul assez pauvre, pour être contraint de se vendre.
La démocratie est ainsi une situation inégalitaire, où il faut que les riches ne soient pas trop riches et que les pauvres ne soient pas trop pauvres, afin que la société reste pacifique. Le pouvoir y est exercé par le peuple pour le peuple.
Le gouvernement est « un corps intermédiaire, établi entre les sujets et le souverain, il est chargé de l’exécution des lois et du maintien de la liberté, tant civile que politique.
La démocratie ne peut pas être parfaite. Un peuple ne peut pas être toujours en train de délibérer. Le peuple doit donc se donner une constitution, qui définit les conditions de la représentation du peuple souverain et l’organisation des pouvoirs, (législatif, exécutif et judiciaire) ainsi que la périodicité des assemblées générales du peuple (pour le renouvellement de sa représentation, notamment).
Les idées de Rousseau énoncent des principes, dont l’application sera fatalement difficile.
Le contrat social repose sur l’acceptation par les citoyens, du renoncement à une part de leur liberté. Précisons : non seulement pour respecter l’égale liberté des autres, mais aussi pour participer à la solidarité qu’exige la fraternité humaine et enfin, le citoyen renonce à une part de sa liberté au profit de sa protection par la puissance publique, à qui il reconnaît le monopole de la violence légitime.
Notons ici le problème de l’expression de la volonté générale, par le peuple souverain. L’expression de la volonté générale, est censée émaner du jugement des citoyens, appelés à s’exprimer par le suffrage. Ceci suppose que chaque citoyen est en mesure de porter un jugement éclairé sur la question en débat. D’où la nécessité, d’une part, d’une instruction générale et d’une éducation à la citoyenneté, de tous les membres de la communauté nationale, et d’autre part, d’une information libre et de sources diverses.
Mais cette idée, que la volonté générale peut se dissoudre dans des associations partielles, dont la somme n’aboutit pas au bien commun, pose le problème essentiel de la démocratie. L’appréciation du bien commun par le citoyen, se traduit en réalité par une opinion, dictée par ses intérêts. Tous les citoyens n’ayant pas les mêmes intérêts, voire ayant des intérêts opposés ou divergents, il est naturel qu’ils s’associent dans des partis politiques, entre citoyens ayant des intérêts convergents. L’usage s’est instauré de considérer que l’intérêt commun, est celui de la majorité. Ce qui est évidemment faux. L’intérêt commun devrait tenir compte aussi de l’intérêt de la minorité, qui en général n’est qu’un peu moins de la moitié du peuple. Un nouveau contrat social devrait mieux assurer, que les décisions du gouvernement sont prises dans l’intérêt de l’ensemble du peuple.
Notons aussi le problème de l’égalité des citoyens. On peut penser, avec Rousseau, que la liberté et l’égalité qui pouvaient régner entre les humains, à l’état de nature, a pris fin avec l’établissement de la propriété, qui accompagnait le progrès apporté par l’agriculture. Beaucoup d’autres progrès se sont produits depuis, qui font que les sociétés humaines sont inéluctablement inégalitaires. Il ne s’agit pas aujourd’hui, de viser à retrouver un mythique état de nature. Mais il paraît urgent de repenser la société, pour qu’elle soit plus juste. Idéalement, la République doit être à la fois : indivisible, laïque, démocratique et sociale. D’où l’idée d’un nouveau contrat social !
La propriété génère le pouvoir. Avec l’agriculture, la propriété de la terre était à celui qui avait la force de la défendre, et auquel se soumettaient ceux qui la travaillaient. Cela conduisit naturellement à une société féodale. L’artisanat et le commerce se développant, il se créa une classe bourgeoise, propriétaire des moyens de production, à laquelle se soumettaient les travailleurs chargés de l’ouvrage. Enfin avec le développement des échanges, la finance est devenue le déterminant de la propriété et le marqueur de l’inégalité.
Il faut là se demander comment appliquer ce principe édicté par Rousseau : « que nul citoyen ne soit assez opulent, pour pouvoir en acheter un autre, et nul assez pauvre, pour être contraint de se vendre. » Nos démocraties occidentales sont très loin de cet idéal utopique. Un nouveau contrat social ne devrait-il pas tenter de s’en rapprocher ?
Réflexions sur l’éventuelle nécessité de concevoir en France un nouveau contrat social
Pour approfondir notre réflexion sur l’éventuelle nécessité de concevoir en France un nouveau contrat social, nous nous inspirerons des idées exprimées par Danièle Sallenave[2] dans son ouvrage : « La Splendide promesse - Mon itinéraire républicain[3] »
Elle évoque Jaurès et souligne : « pour lui la République est incomplète, elle est inachevée, tant que la démocratie sociale ne vient pas accomplir la démocratie politique. » En effet, la république ne s’est imposée que tardivement, après la chute du Second Empire, difficilement, face à un fort courant réactionnaire, et progressivement, avec une avancée sociale remarquable après la deuxième guerre mondiale, en appliquant des mesures proposées par le programme du Conseil National de la Résistance. Des régressions se sont produites et sont toujours possibles. En l’état actuel, elle apparaît comme inachevée, notamment dans son caractère social.
Déjà, selon Robespierre : « Pour faire advenir le bonheur de tous, le bonheur du peuple, le bonheur des masses, il faut donc concevoir une refonte radicale des rapports de pouvoir, de domination, qui rende possible une égalité face au savoir, à la connaissance, un usage juste et réfléchi du monde. Pour cela nous voulons un ordre de choses où toutes les passions basses et cruelles soient enchaînées, toutes les passions bienfaisantes et généreuses éveillées par des lois (…) où le commerce [soit] la source de la richesse publique, et non seulement l’opulence monstrueuse de quelques maisons[4]. »
Un contrat social, cela implique dans une certaine mesure une conception socialiste, de l’organisation de la société. Or en France, depuis la Révolution, il y a toujours eu deux conceptions du socialisme : à l’origine, la gauche jacobine centralisatrice et étatique et une deuxième gauche (girondine ?) régionaliste et autogestionnaire ; au siècle dernier, une gauche de rupture, pour une rupture avec l’ordre établi par la société capitaliste, et une deuxième gauche dite social-démocrate, pour un aménagement social de la société capitaliste. Aujourd’hui il est question d’une troisième gauche, dite post-sociétale ? Il semble qu’il s’agisse là d’une gauche qui fédère les minorités en délaissant les problèmes de revenus. Dans l’idée d’un nouveau contrat social, il faudra savoir quel socialisme l’on veut faire advenir.
C’est parce que cette nécessité du caractère social de la démocratie a souvent été oubliée, qu’un peu partout dans le monde, la tentation du communisme s’est exercée sur les plus pauvres et les plus déshérités. L’idée révolutionnaire d’égalité, s’est corrompue dans une déviation de la grande promesse, en grande oppression. Ceux qui ont imaginé, ou même soutenu, un prétendu internationalisme prolétarien, ont aidé en fait, une prise de pouvoir sur le peuple et ses aspirations, édifiée par la terreur et prolongée par la pénurie.
La racine du mal, serait la propriété privée, inscrite dans les droits fondamentaux et aujourd’hui devenue quasi-intouchable, car financière et hors-sol. C’est ce qui rend la démocratie sociale si difficile. Robespierre[5] déjà s’exprimait sur les correctifs nécessaires, qui doivent accompagner le droit de propriété ; convaincu que l’égalité des biens est une chimère, il préconisait que le droit de propriété soit borné, par l’obligation de respecter les droits d’autrui. La République est incomplète, inachevée, tant que la démocratie sociale ne vient pas accomplir la démocratie politique. Malheureusement, les démocrates républicains n’ont pas su faire entendre qu’il y avait incompatibilité, entre l’intérêt général et un monde axé sur la croissance, avec l’individualisme consommateur.
Cette question des limites au droit de propriété est le point névralgique de l’idée sociale. Il pose trois problèmes : la détermination des critères et des modalités de limitation de la propriété privée ; la définition de l’entité sociale détentrice légitime de la propriété commune ; l’entrée de la finance dans la limitation de ce droit de propriété.
Aujourd’hui, l’une des principales propositions de l’économiste thomas Piketty est de remplacer la propriété privée par la propriété sociale et temporaire. Une autre idée serait de considérer que le peuple, qui est censé être le souverain, est le propriétaire de la richesse nationale, et distinguer ce qui appartient à la puissance publique de ce qui appartient au privé, en considérant que l’intérêt public doit toujours avoir le pas sur l’intérêt privé.
La mise en œuvre du principe de fraternité, supposera toujours une politique capable de corriger les effets sociaux négatifs, du droit de propriété[6]. Se dire républicain c’était, contre la domination d’une aristocratie, imposer des valeurs démocratiques : combattre « pour les faibles contre les puissants, pour le peuple contre ceux qui l’oppriment, pour la justice sociale contre l’iniquité et contre l’injustice[7] ». La république est inachevée, si elle n’est pas en même temps une république sociale. Il ne faut pas renoncer à la promesse républicaine émancipatrice, qui voulait mettre fin à la domination par le capital économique, à laquelle s’ajoute la domination par le capital culturel. L’école n’est plus l’école « libératrice » qu’elle devait être.
Ce constat, de l’abandon de l’idéal républicain par notre Éducation Nationale, doit nous inciter à réfléchir à l’importance de l’inscription dans un nouveau contrat social, d’une véritable éducation nationale républicaine pilier de la République, une école au service de tous, une école capable d’assurer à chacun, non seulement les conditions de son émancipation et son insertion dans la vie citoyenne, mais une école apprenant à devenir un libre citoyen, mettant sur le chemin par lequel on quitte sa maison, sa famille sans l’oublier, afin de découvrir une plus vaste communauté et d’autres solidarités, une école assurant l’égalité des chances et donnant accès à l’ascenseur social[8]. D’où la nécessité d’une réforme politique et sociale, d’une refonte, d’une refondation de l’école.
Il faudrait dans un nouveau contrat social, réhabiliter l’égalité des chances et l’élitisme républicain, repenser une école républicaine donnant à chaque membre de la communauté nationale, outre l’instruction propre à lui permettre de se rendre utile à la société par son travail, une formation de citoyen initié à l’éthique humaniste et à la laïcité.
La laïcité, qui consiste essentiellement à confiner les manifestations d’appartenance religieuse au domaine privé ou associatif, considérant que les conceptions métaphysiques sont du domaine exclusif de l’appréciation individuelle de chacun, est la règle de vie qui peut seule permettre la coexistence pacifique, de citoyens libres d’avoir chacun la religion de son choix, ou de ne pas en avoir ; la vie publique étant régie par la même loi pour tous.
À ce sujet il faut rappeler cette adresse de Clemenceau aux catholiques : « Le jour où votre religion serait atteinte dans sa liberté légitime, vous me trouveriez à côté de vous, pour vous défendre ; au point de vue politique, bien entendu, car au point de vue philosophique, je ne cesserai d’user de ma liberté pour vous attaquer[9]. » Il reste à l’État le devoir de veiller à ce que la pratique religieuse soit un choix individuel libre, et qu’elle n’entraîne pas d’infraction aux lois de la République.
L’immigration est en France un fait déjà ancien. Quelle que soit la politique conduite à l’avenir, la diversité ethnique, religieuse et culturelle de la population, est une réalité dont il faut tenir compte. « Il convient de se méfier. Le modèle d’une Europe de la civilisation, une Europe blanche et suprémaciste, peut toujours se réactiver, cette fois contre les populations venues d’ailleurs. » L’histoire de la France a vu, déjà sous la royauté, l’unification de provinces, diverses par la culture, la langue, les usages… notre Fête Nationale est la commémoration de leur fédération volontaire dans l’unité de la Nation le 14 juillet 1790. L’unité n’est toutefois pas l’uniformité. Ce principe étant admis, il reste, dans un nouveau contrat social, à décider la forme que doit prendre, au sein de la communauté citoyenne nationale, la reconnaissance des minorités, ethniques, linguistiques et religieuses.
L’universalisme est l’un des héritages majeurs de la grande Révolution… Toutefois, les républicains les plus convaincus n’ont pas toujours été capables de mesurer, de quelles dérives suprémacistes était secrètement porteur l’universalisme, compris comme une extension de notre culture. Or, un universalisme qui nie les particularités est pernicieux ; mais un particularisme qui ne s’inscrit pas dans une perspective universelle, est également néfaste. L’universalisme est une totalité, faite de particularités et de diversité[10]. La France a proposé au monde, une appartenance à la cité par-delà les origines et les déterminations de naissance, un projet de construire des sociétés politiques, rassemblant des citoyens émancipés, maîtres de leur propre destin, unis par la seule raison : la nation citoyenne.
Un nouveau contrat social devrait donc bien définir les modalités, de l’intégration des minorités de toutes natures vivant sur le sol de la France, dans la communauté nationale citoyenne. Mais, est-il possible que la France ait dans ce domaine, de l’intégration des diversités et de la laïcité, une politique qui ne soit pas celle des autres pays de l’Europe ? Ceci pose le problème de la souveraineté nationale dans le cadre de l’Europe.
La souveraineté nationale n’a plus la valeur qu’elle a pu avoir dans le passé. Le monde libre, champion de la civilisation, a créé « une association douteuse entre la liberté politique et le libéralisme économique. » Le monde de la finance et des affaires, doit désormais selon l’idéologie dominante, pouvoir opérer librement, à l’abri de toute intervention restrictive des états. L’Europe s’est constituée sur la base de cette idéologie, enlevant à la nation l’essentiel de son pouvoir sur la monnaie et l’économie, et lui imposant dans un grand nombre de domaines, des contraintes que la représentation nationale n’a pas eu à délibérer. L’idée de nation se dissout, dans la construction européenne.
Pour la Défense Nationale aussi, la France a abandonné la part d’autonomie qu’avait maintenue le pouvoir gaulliste, pour se ranger dans la position de vassalité, dans une Europe soumise à la suzeraineté des États-Unis, et dans le cadre de l’Otan. Le 14 juillet, le drapeau tricolore et la Marseillaise, la nation une et indivisible, l’universalisme, la langue française, l’élitisme républicain, la laïcité… chacun de ces thèmes a subi une déconstruction…
Un démocrate peut-il renoncer à soutenir, qu’il ne peut y avoir de souveraineté que venant du peuple. L’Europe, c’est l’émergence d’une souveraineté sans nation et sans peuple. Or, la défense de la Nation est l’affaire du souverain qu’est le peuple.
Le patriotisme doit rester appuyé sur une idée de la nation, héritée de 1789, « une et indivisible », collectivité volontairement construite, vecteur moderne de la mise en œuvre politique d’un bien commun, lui-même voulu et librement défini.
La mise en pratique d’un nouveau contrat social en France, fidèle aux principes des pères fondateurs de notre République, sera fatalement rendue très difficile par la dissolution de la Nation dans une Europe mal construite et soumise à l’autorité suprême du néolibéralisme mondial.
On peut prévoir que le populisme ambiant, exploitant le sentiment d’aliénation de groupes sociaux qui se sentent exclus de l’exercice effectif de la citoyenneté, inspire l’idée que la rupture s’impose, avec un système économique et politique, fondé sur la croissance, le profit, le libre-échange et une concurrence généralisée. Par retour du balancier, les plus pauvres et les déshérités, désillusionnés des expériences collectivistes, se soumettront ainsi à des enchanteurs de foule, potentiels dictateurs. Il restera cependant, dans la mesure où la République se maintiendra, la possibilité pour la petite classe moyenne de tenter de réveiller d’anciennes alternatives politiques, économiques et symboliques… et des formes disparues d’économie sociale et solidaire ; une sorte de progressisme conservateur.
Pour maintenir la République, contre vents et marées, l’idée d’un nouveau contrat social reste une ambition salutaire. L’identité nationale et les solidarités collectives, sont centrales dans l’esprit de la plupart des Français[11].
L’identité nationale est à conjuguer avec l’immigration. C’est une identité citoyenne nationale qu’il faut faire entrer dans les mœurs. Et d’abord par une éducation nationale commune de tous les citoyens.
Les solidarités collectives, ont aussi à voir avec l’immigration. L’immigré se sent naturellement solidaire de ses congénères avec lesquels il s’associe, formant communauté[12]. Il faut par la loi, bien définir les règles de ces associations, pour faire en sorte que la solidarité citoyenne, au niveau national, l’emporte sur toute autre.
Il reste à savoir si notre République peut évoluer vers plus de social, malgré les freins que lui opposeront l’Union Européenne et l’idéologie néolibérale.
Il est néanmoins urgent de mettre en chantier un contrat de citoyenneté française, dans une République indivisible, laïque, démocratique et sociale autant que possible.
[1] « Du contrat social » Félix Alcan éditeur, Paris 1896, consultable sur internet.
[2] Danièle Sallenave, née le 28 octobre 1940 à Angers, en Maine-et-Loire, est une écrivaine française, membre de l'Académie française.
[3] Ouvrage publié par Gallimard le 27 février 2025 ; dont sont extraits les termes cités entre guillemets.
[4] 18 pluviose an II
[5] Le 24 avril 1793.
[6] Selon Yannick Bosc, cité par Danièle Sallenave.
[7] Disait Jaurès, cité par D.S.
[8] Inspiré du texte de D.S.
[9] Cité Par D.S.
[10] Formule d’Enzo Traverso citée par D.S.
[11] David Goodhart « les progressistes doivent admettre que l’identité nationale et les solidarités collectives sont centrales aux yeux de la plupart des citoyens »… Propos recueillis par Kévin Boucaud-Victoire - Publié le 27/06/2025 à 7:00
[12] Comme autrefois s’associaient les provinciaux venus chercher du travail dans la métropole parisienne.